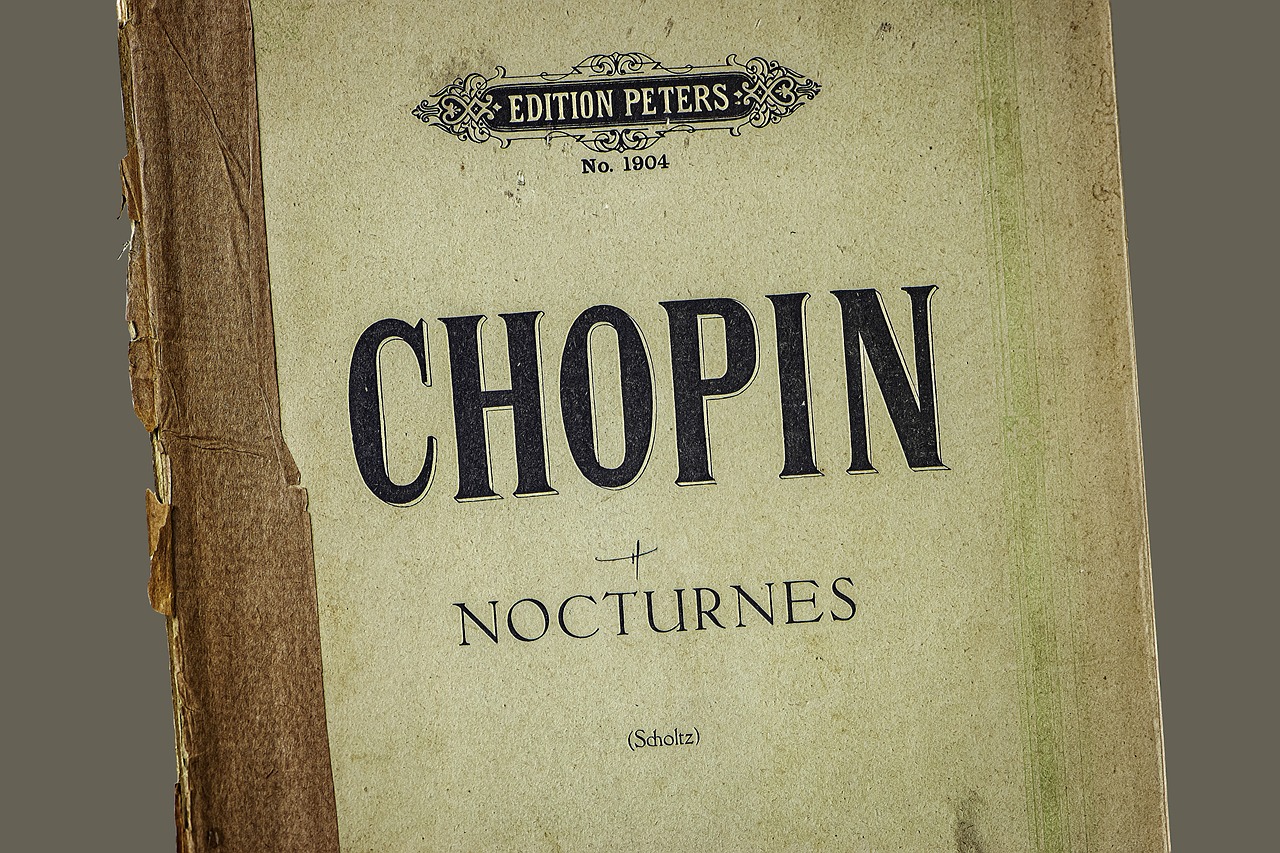Frédéric Chopin 1810-1849
La Pologne
Selon la légende, des violoneux qui avaient parcouru une douzaine de lieues en traîneau depuis Varsovie jusqu’à Zelazowa Wola en Mazovie jouaient encore à la nuit tombante, ce jeudi 1er mars 1810 (une déclaration tardive au registre paroissial avait donné, par erreur, la date du 22 février), sous les fenêtres de la chambre où Frédéric Chopin venait au monde.
Son père, Nicolas, fils d’un charron-vigneron, avait quitté sans regret Marainville et sa Lorraine natale dès l’âge de seize ans, sans doute pour échapper à un avenir médiocre. L’ancien régisseur polonais du château lui avait fourni de solides appuis à Varsovie.
A la naissance de Frédéric, Nicolas était complètement intégré à sa nouvelle patrie et à sa culture. Il se prénommait Mikolaj, époux de Justyna Krzyzanowska.
A vingt ans Chopin n’avait plus rien à prouver dans son pays. Après l’enfant prodige qui avait, à sept ans, composé deux polonaises et joué devant la mère du Tsar, le jeune adolescent était devenu l’habituel invité des salons de Varsovie où sa virtuosité de pianiste et son talent d’improvisateur attiraient l’attention des critiques qui osaient le comparer à Mozart.
Il avait déjà composé une cinquantaine d’œuvres – certaines aujourd’hui disparues – présentées au cours de brefs séjours en Allemagne et en Autriche où il fit un triomphe au Théâtre Impérial le 11 août 1829 comme, quelques mois plus tard, au Théâtre National de Varsovie où il donna, devant une salle bondée, son Concerto en fa mineur.
Mais son père comme ses professeurs pensaient qu’il devait asseoir sa jeune renommée à travers toute l’Europe. Contrairement à ce père quittant allègrement son pays natal, c’est le cœur serré et rempli d’inquiétude pour son avenir que Frédéric montait dans la diligence, le mardi 2 novembre 1830 après un concert d’adieu où son deuxième Concerto en mi mineur souleva l’enthousiasme. Il se rendrait à Dresde puis à Vienne. « J’ai l’impression de partir pour ne plus revenir … qu’il doit être triste de mourir loin des siens ! », confiait-il à un ami. Sa mère, quant à elle, réussissait à taire son anxiété de voir s’éloigner ce garçon frêle et délicat comme l’était sa jeune sœur emportée à quatorze ans par la phtisie.
Chopin et Paris
Il projetait de quitter Vienne pour Londres lorsque lui parvint la nouvelle de l’insurrection de Varsovie. Partagé entre une sorte de honte à ne pas participer à la lutte aux côtés de ses amis insurgés et l’impossibilité de demeurer à Vienne où l’on prenait parti pour le Tsar, il pensa être accueilli avec plus de bienveillance dans le Paris post-révolutionnaire. Paris donc, où il arriva le 11 septembre 1831 – Paris où la rencontre, un jour sur les boulevards, avec le Prince Radziwill qui l’admirait, allait lui ouvrir les portes des salons – Paris, acquis à la cause polonaise, où il côtoya Chérubini, Mendelssohn, la Malibran, les pianistes de renom, avant de devenir lui-même, comme il l’écrivit à ses parents « la coqueluche parmi la crème de l’aristocratie française ».
Le 26 février de l’année suivante : un premier concert à la Salle Pleyel. Il y donna ses Variations sur un air de Don Juan qui inspirèrent à Robert Schumann le fameux « Chapeau bas, messieurs, un génie » et enthousiasmèrent Franz Liszt. Mais il hésiterait longtemps avant de se produire de nouveau : « Je ne suis point propre à donner des concerts, moi que le public intimide, déclarait-il, … je me sens asphyxié par les haleines précipitées, paralysé par ces regards curieux, muet devant ces visages étrangers ».
Devenu rapidement le professeur le plus demandé – et le plus cher – de la capitale, il pouvait mener grand train sans être astreint à ces concerts pour lesquels il montrait tant de répugnance. Jouer, improviser pour un cercle d’amis lui conviendrait toujours mieux.
Frédéric Chopin rencontre George Sand
Ce fut à l’occasion d’une de ces soirées qu’il se trouva en présence de George Sand à l’automne de 1836. Liszt avait dû insister pour que le musicien participât chez Marie d’Agoult à l’une de leurs rencontres musicales. La romancière avouerait bientôt à un ami avoir été troublée autant par l’aspect fragile de « ce petit être » que par la force de son talent. Chopin, lui, retarda longtemps le moment d’envisager ce qu’elle appelait « le dernier embrassement de l’amour ». Ils se virent fréquemment, soit dans des réunions intimes, soit dans les salons, avant quelques tête-à-tête et voyages « … dans d’autres régions …, livrés au vent qui passait ». On peut supposer que le début de leur liaison amoureuse date de mai 1838 ; en juin Delacroix, leur ami commun, commença la célèbre toile qui réunit si fortement le maître au piano et la jeune femme comme subjuguée par la musique.
Puis, en novembre, le départ pour Majorque avec les deux enfants de George Sand, un séjour dont la romancière fera plus tard un récit accablant pour l’Espagne, « cette terre de brigands et de vermine …ce chien de pays » où la santé de Chopin s’était détériorée « d’une manière effrayante », où ils avaient été « … comme des parias à cause de la toux de Chopin ».
Chopin et Nohant
Après « le fiasco » des Baléares, le couple passait, le 1er juin 1839, la grille de la grande demeure. Chopin allait vivre son premier été en Berry.
Il y reviendrait au cours de sept étés jusqu’en 1846 – plus de 1000 jours – et ce serait désormais le lieu privilégié pour sa création. A la fin de chaque hiver, il serait heureux de quitter un Paris humide et froid où son état de santé s’aggravait, heureux d’interrompre un temps les contraintes des leçons de l’après-midi et des soirées mondaines à la longue fastidieuses.
A Nohant, il était sûr de retrouver la chaleur d’un foyer, une chambre ouverte au soleil sur le jardin, une compagne attentive à son confort et au calme indispensable à son travail … et un bon piano. Même si l’on refuse l’idée simpliste d’expliquer la genèse des quelque cinquante chefs-d’œuvre composés à Nohant par la seule qualité de l’air ou le dévouement de l’hôtesse, force est de constater que Chopin n’a plus rien composé après Nohant et la rupture avec George Sand en 1847. Une dernière Mazurka qu’il dit « devoir tirer de son cœur lacéré » restera inachevée à sa mort dans la nuit du 17 octobre 1849.
Texte de Sylvie Delaigue-Moins